Le cinéma iranien à hauteur d’homme
Le cinéma iranien, plus que tout autre, a su développer une esthétique de l’élision, du non-dit, et de la résistance douce. Au pays de nos frères, premier long-métrage de Raha Amirfazli et Alireza Ghasemi, s’inscrit dans cette tradition. Mais il en renouvelle les contours. Ce n’est plus seulement l’Iran des frontières géographiques qui est en jeu, mais celui des marges humaines, celui des non-citoyens, des réfugiés afghans, assignés à une invisibilité sociale prolongée.
Raha Amirfazli : une cinéaste de la tension silencieuse
Raha Amirfazli est une réalisatrice formée à la Tisch School of the Arts (New York), mais ses racines, profondément ancrées en Iran, nourrissent sa démarche. Elle n’a jamais renié sa culture d’origine, mais la regarde avec la distance de l’exil. Avant ce long-métrage, ses œuvres brèves — souvent sélectionnées dans des festivals comme Sundance — creusaient déjà un sillon : l’individu face à une société opaque, une narration morcelée mais lucide, des personnages qui tentent de composer avec un pouvoir diffus, presque abstrait. Son coréalisateur Alireza Ghasemi, quant à lui, est remarqué en 2017 pour Lunch Time, court-métrage déjà tourné autour du silence et du refus de répondre. Ces deux regards conjugués donnent à leur film une forme d’humanisme sans fioritures.

Trois décennies, trois récits, un seul peuple sans nom
Au pays de nos frères articule sa narration sur trois temporalités : 2001, 2011, 2021. À chaque époque, un personnage afghan devient le point de fuite : un jeune adolescent ambitieux, une femme esseulée, un homme usé. Chacun lutte, dans l’ombre, pour exister, sans jamais vraiment espérer d’avenir. Le récit refuse l’héroïsme. Il choisit le trivial, le répétitif, la douleur ordinaire. Il ne s’agit pas de dénoncer frontalement, mais de montrer les effets structurels d’un racisme institutionnalisé, presque accepté comme allant de soi.
Une mise en scène de l’invisible
La caméra est discrète, presque effacée. Les réalisateurs optent pour une mise en scène épurée, qui fait confiance aux hors-champs et aux silences. La photographie adopte une palette sourde, jamais misérabiliste. Ce qui frappe, c’est l’absence d’insistance. Pas de violons, pas de ralentis lacrymaux. Juste des corps fatigués, des gestes retenus, des regards qui n’osent pas s’élever. La cinématographie épouse le rythme du monde qu’elle dépeint : ralenti, inerte, exclu de la vitesse contemporaine.
Une distribution bouleversante de vérité
Les réalisateurs ont fait le choix fort de confier les rôles à des non-professionnels, tous issus de la communauté afghane en Iran. Le résultat est saisissant. Mohammad Hosseini, qui incarne le jeune adolescent du premier segment, déploie une fragilité qui n’a rien d’apprêté. Hamideh Jafari, dans le second acte, impressionne par la retenue de son jeu, ses silences tendus comme des fils. Mais c’est peut-être Bashir Nikzad, dans le rôle de Qasem, qui laisse la trace la plus durable : un homme qui porte le poids des renoncements, sans jamais hausser la voix. Ce choix de casting, loin d’être anecdotique, participe pleinement de l’intention politique du film : donner la parole à ceux qui en sont privés, même dans la fiction.
Une reconnaissance méritée
Le film a déjà reçu plusieurs distinctions, dont le prix de la mise en scène à Sundance 2024 et le Grand Prix à Saint-Jean-de-Luz. Ce n’est pas un hasard. Les jurys, souvent sensibles aux causes sociales, ont ici reconnu une œuvre qui dépasse le seul propos militant pour offrir une expérience cinématographique singulière. Car Au pays de nos frères n’est pas un tract : c’est une méditation filmique sur l’effacement, sur l’attente comme mode d’existence.

Que reste-t-il en sortant de la salle ?
On sort du film en silence. Pas de choc, pas de révolte immédiate. Plutôt une gêne sourde, une honte légère mais persistante, comme un voile sur les épaules. On se surprend à penser à ceux qu’on ne regarde jamais. On se demande ce que veut dire “frère”, au juste. La promesse du titre — Au pays de nos frères — sonne comme une ironie douce-amère. Ce pays n’est pas un lieu, mais un espoir jamais formulé.
Un premier film à la hauteur de ses ambitions
Avec Au pays de nos frères, Amirfazli et Ghasemi signent un film sobre, dense, et nécessairement politique. Sans grand discours, ils exposent les angles morts d’une société, la réalité d’un peuple sans voix. C’est une œuvre qui regarde sans commenter, qui filme sans habiller, et qui laisse au spectateur la responsabilité de son propre malaise.
En cela, elle s’inscrit pleinement dans la tradition du grand cinéma iranien. Celui qui, sous la censure ou dans l’exil, continue de dire l’indicible.



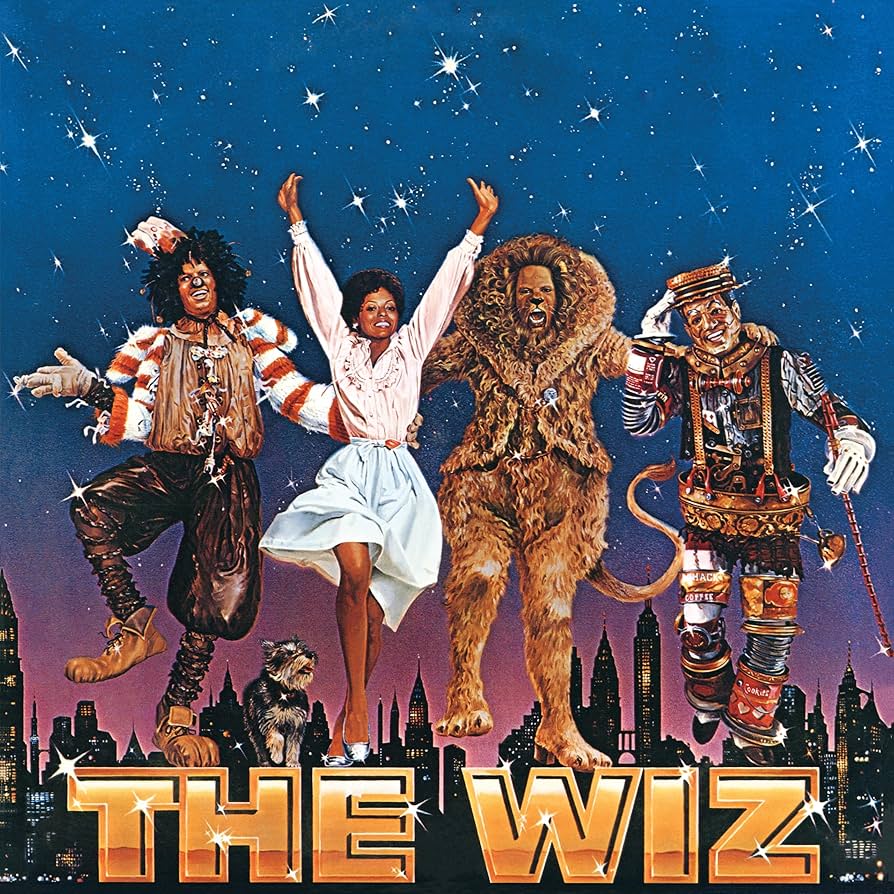
Soyez le premier à commenter cet article !