Le parcours des auteurs : une conscience politique affûtée
Henri Poulain est un nom familier pour les amateurs de journalisme visuel engagé. Il est notamment connu pour sa collaboration au sein du collectif Datagueule, un format web-documentaire ayant marqué les esprits par sa capacité à décortiquer les mécaniques du pouvoir avec rigueur et pédagogie. À ses côtés, Julien Goetz et Sylvain Lapoix, journalistes et co-auteurs réguliers du projet, incarnent cette même volonté de rendre intelligibles les rouages politiques et économiques qui façonnent nos sociétés.
Leur film Démocratie(s), prolongement naturel de leurs travaux précédents, s’inscrit dans une veine documentaire éducative, dense et didactique, où l’image vient servir un propos clair : faire émerger une interrogation lucide sur l’état actuel de nos systèmes démocratiques.
Une proposition documentaire sans acteur, mais avec des voix
Il ne s’agit pas ici d’un film porté par des comédiens mais d’un documentaire nourri par des intervenants : politologues, chercheurs, citoyens, acteurs associatifs. Ce sont leurs paroles, leurs analyses, leurs vécus qui forment l’épine dorsale du récit. L’absence d’acteurs au sens traditionnel du terme est compensée par une direction d’interview maîtrisée, où chaque propos est remis dans son contexte, soutenu par une mise en scène sobre et efficace.
Lire aussi : Le Cinéma Vérité : miroir brisé ou reflet lucide ?
Certains témoignages brillent par leur force explicative : le politologue Loïc Blondiaux, par exemple, éclaire les failles représentatives avec une rigueur exemplaire. De même, les interventions citoyennes — parfois filmées dans l’espace public — apportent un contrepoint salutaire à la parole experte.
Une intention claire : réinterroger le mot « démocratie »
Le point de départ du film tient dans cette simple interrogation du titre : pourquoi ce « s » entre parenthèses ? Les auteurs veulent ouvrir un champ de réflexion plutôt que proposer une réponse définitive. Il s’agit moins de dénoncer que de cartographier les possibilités : démocratie représentative, démocratie directe, participative, délégative… chaque déclinaison est présentée comme une tentative, jamais comme un modèle absolu.

Ce qui transparaît, c’est la volonté de rendre visible l’écart entre le mot et sa mise en pratique. La démocratie est ici vue comme un processus, non comme un état acquis. Un chantier permanent, où le citoyen doit être acteur, pas simple spectateur.
Le sentiment en sortant de la salle : lucidité et responsabilité
Démocratie(s) n’est ni un réquisitoire, ni une œuvre de désespoir. C’est un film qui éveille, qui invite à la vigilance et à la réflexion collective. On en sort avec un sentiment mêlé : la lucidité sur l’état des institutions, mais aussi la conscience qu’un autre rapport au pouvoir est possible. Le ton, à aucun moment moralisateur, appelle à l’émancipation par la compréhension.
Une mise en forme accessible, fidèle à la culture numérique
Visuellement, le film emprunte aux codes du format web, avec des animations sobres, une typographie claire, une infographie pensée pour accompagner le discours sans l’étouffer. La voix off, posée et neutre, accompagne le spectateur sans jamais imposer un regard. Le rythme est soutenu, chaque séquence ouvre vers une autre, dans une progression logique et maîtrisée.
En somme, Démocratie(s) s’inscrit dans la tradition d’un cinéma documentaire citoyen, qui ne cherche pas à imposer une vérité mais à donner au spectateur les clés pour construire la sienne. Il prolonge et densifie le travail de Datagueule, en offrant une fresque contemporaine où le mot démocratie redevient une question vivante.
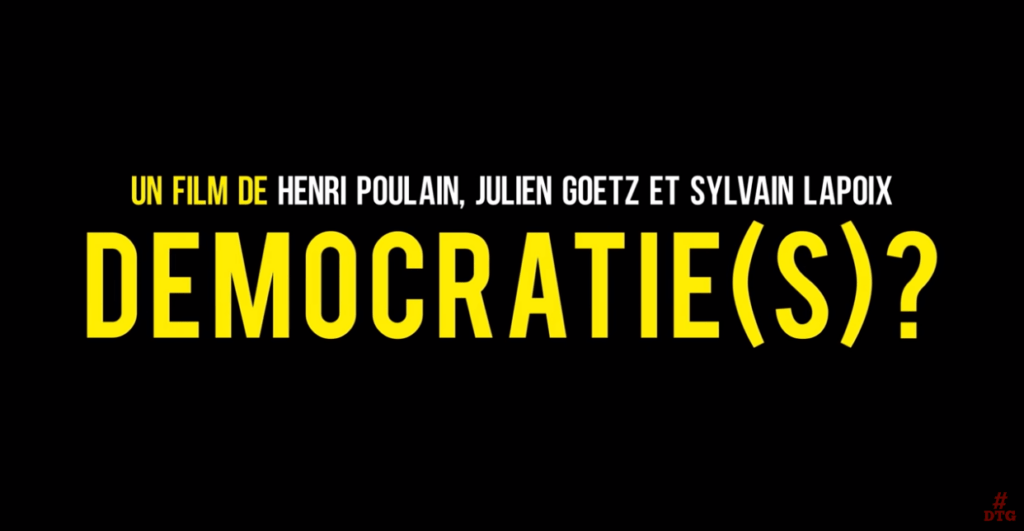
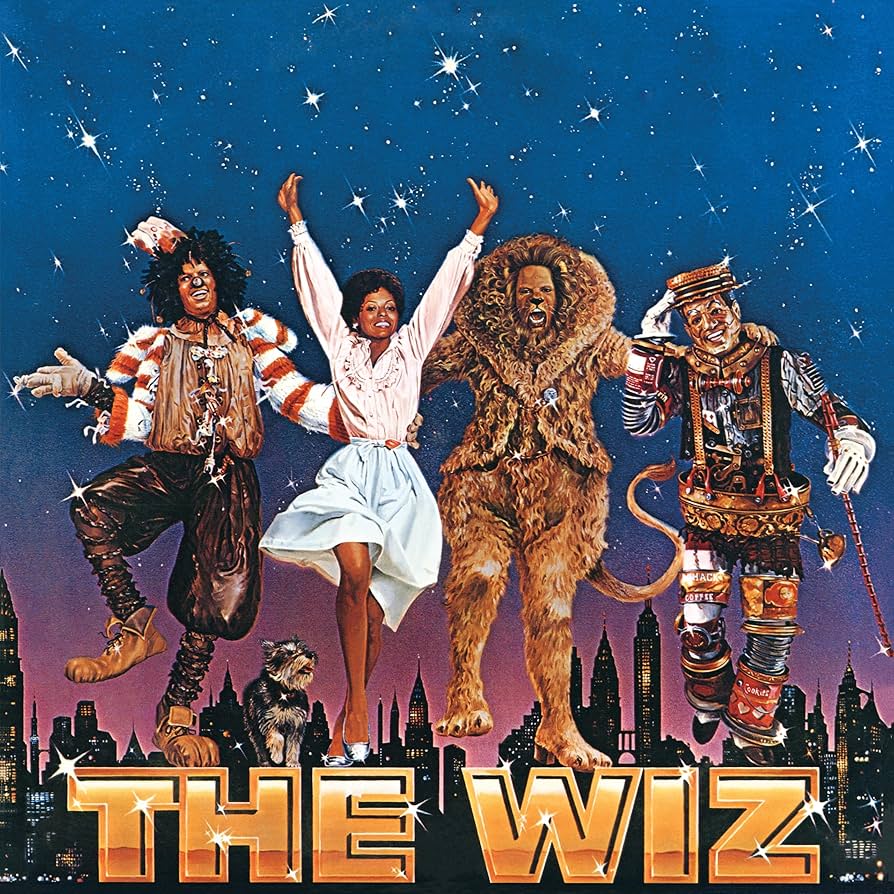


Soyez le premier à commenter cet article !