Une chronique douce-amère du passage à l’âge adulte
Guillaume Brac, fidèle à sa démarche de cinéaste du réel, prolonge son exploration de la jeunesse et des liens fugaces dans Ce n’est qu’un au revoir, documentaire tourné à Die, dans la Drôme. Après À l’abordage ou Contes de juillet, il revient au format documentaire avec une attention toujours aussi fine portée aux gestes simples, aux silences partagés, à l’infra-ordinaire.
Son style, souvent qualifié de naturaliste, puise autant dans le cinéma documentaire que dans les échos d’un Rohmer tardif, sans jamais céder à l’affectation ou à la pose. Il observe, laisse émerger, capte l’humanité dans ses flottements.
Que raconte Ce n’est qu’un au revoir ?
Le film suit la dernière semaine d’un groupe de lycéens internes dans un établissement rural. Ce sont des jeunes venus de villages éloignés, parfois isolés, qui ont tissé entre eux des amitiés intenses à l’internat. Alors que l’année scolaire s’achève, l’heure des séparations approche. Plutôt que d’en faire un drame, Brac capte ces adieux avec une sensibilité désarmante.
Aucun commentaire en voix off, aucune musique illustrative : le regard est brut, sans fard, mais profondément humain. On entend des jeunes parler de leur avenir, d’un amour discret, d’un lien qui va peut-être se perdre. La caméra circule doucement entre les chambrées, les cours, les sentiers boisés, les rivières où l’on se baigne une dernière fois.
Niveau de jeu : des acteurs dans le sillon de la vérité
Le film se tient sur une ligne ténue : ni enquête sociologique, ni fiction déguisée. Ce n’est pas un manifeste. C’est un regard. Une présence discrète mais constante. On pense à Wiseman pour la rigueur, à Rohmer pour les interstices affectifs, à Claire Simon pour l’écoute.

Brac filme les visages comme des paysages : changeants, incertains, traversés par des émotions qu’il ne cherche jamais à nommer. Il laisse le spectateur recevoir sans orienter, accueillir sans juger.
Quelle intention sous-tend le film ?
Ce n’est qu’un au revoir interroge la nature du lien : qu’est-ce qui reste, une fois l’année écoulée, les chambres vidées, les bus repartis ? Loin du pathos ou de l’angélisme, le film affirme une chose essentielle : les instants partagés comptent, même s’ils n’ont pas de lendemain. Et cela suffit à leur donner du poids.
C’est cette confiance dans la valeur du fugace qui donne au documentaire toute sa douceur, sa lumière particulière. Il y a dans cette chronique d’adolescents une mélancolie calme, un apaisement silencieux face au passage du temps.
Quel sentiment en sortant de la salle ?
On sort du film touché, mais sans être écrasé. C’est une mélancolie modeste, sans ostentation. Une œuvre qui ne cherche pas à démontrer mais à ressentir. Le geste de Brac est celui d’un artisan du regard : attentif, modeste, d’une exigence tranquille.
Ce n’est qu’un au revoir confirme la cohérence d’une œuvre discrète mais singulière, dans le paysage du cinéma français contemporain : un cinéma qui croit encore à la puissance du réel, à la beauté du présent, et à l’inestimable richesse des liens humains.
Conclusion
Guillaume Brac poursuit ici une œuvre cohérente, profondément ancrée dans le réel, sans jamais céder aux effets faciles. Ce n’est qu’un au revoir n’est pas un manifeste, mais une fenêtre entrouverte sur un monde souvent ignoré.
Un film qui réconcilie le spectateur avec le simple fait d’être là, d’être présent, de partager un moment, aussi fugace soit-il.



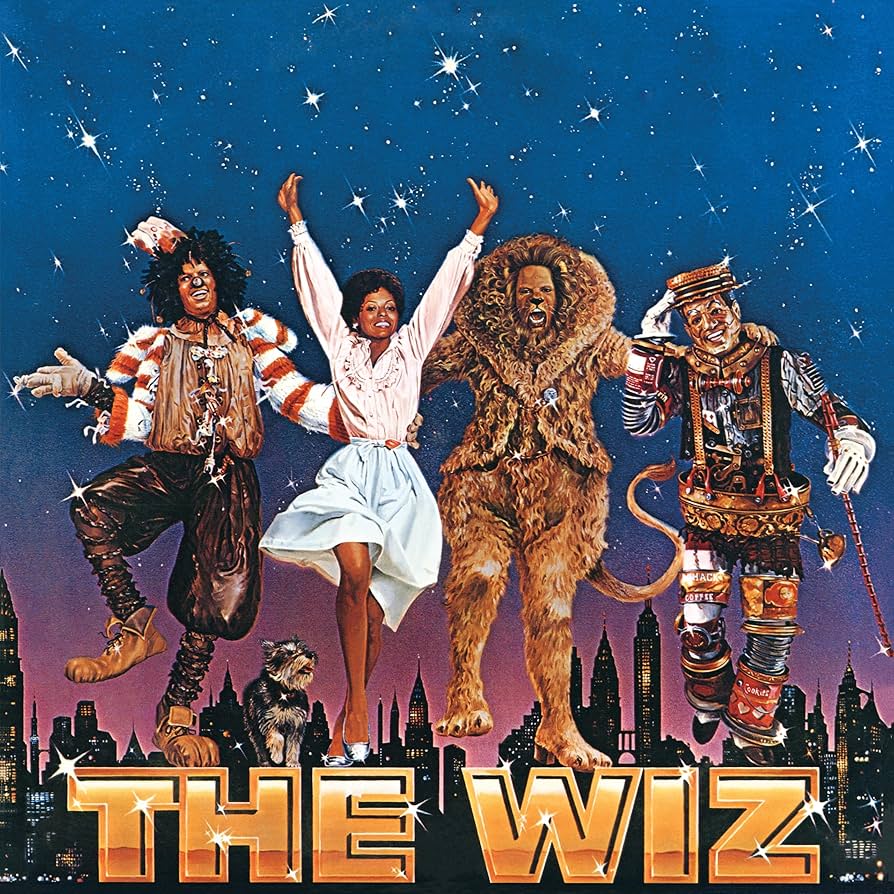
Soyez le premier à commenter cet article !